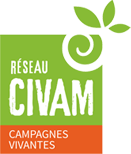Dans les différentes études menées par la Chambre d’agriculture de Bretagne, l’Inrae, ou l’Idele, la monotraite apparaît comme un choix motivé par deux aspects :
- Aspects techniques : gérer le quota, écrêter le pic de lactation, favoriser la reproduction, provoquer un tarissement naturel…
- Aspect travail : réduire le temps de travail, lisser le pic de travail au printemps, limiter le coût du remplacement, améliorer l’efficacité au travail)…
Le passage en monotraite intégrale produit une baisse de 25 à 30% de la production laitière, sans effet rémanent d’une lactation à l’autre. Son caractère réversible en fait un levier souple et «sans engagement» pour réduire temporairement ou durablement la charge de travail.
La qualité du lait est modifiée en monotraite : +2.8 g/kg de taux butyreux et +1.5 g/kg de taux protéique. La valorisation des taux dans les grilles de prix permet de compenser pour partie la perte économique liée à la baisse de la production.
La monotraite a aussi un effet positif sur la reproduction : les animaux étant en meilleur état, la fertilité et la fécondité sont améliorées. Et la valorisation économique des réformes s’en ressent ! Du côté des charges d’alimentation, l’ingestion annuelle semble stable par rapport à la double traite : de 0 à -10% selon les sources.
 Dans les simulations économiques réalisées lors d’un essai à Trevarez (2002-2005), l’impact économique est mesuré sur la marge brute à volume constant (augmentation du cheptel et de la SFP) de l’ordre de + 8000€ ou -38 000€ lorsque le nombre de vaches reste constant. Une chose apparaît clairement : le passage en monotraite ne doit pas s’accompagner d’investissement dans les charges de structures !
Dans les simulations économiques réalisées lors d’un essai à Trevarez (2002-2005), l’impact économique est mesuré sur la marge brute à volume constant (augmentation du cheptel et de la SFP) de l’ordre de + 8000€ ou -38 000€ lorsque le nombre de vaches reste constant. Une chose apparaît clairement : le passage en monotraite ne doit pas s’accompagner d’investissement dans les charges de structures !
Impacts de la monotraite sur la durabilité des systèmes herbagers
Dans le groupe de Bain de Bretagne, membre de l’Adage, certaines fermes pratiquent depuis quelques mois la monotraite toute l’année. D’autres sont en monotraite pendant quelques semaines ou quelques mois, et d’autres l’utilisent le dimanche soir.
Les membres du groupe ont débattu des implications en terme de durabilité de la monotraite, mettant en avant :
- Le travail : la monotraite permet une meilleure conciliation de la vie perso/pro d’après ses praticien.nes. Pour d’autres personnes, cela change profondément le rapport au travail et à la traite de l’éleveur et de l’éleveuse. « Quel est le nombre d’heure minimal de travail en élevage laitier ? » entend-on… Tiens ! Ce n’est pas fréquent comme question en agriculture !
- L’astreinte : Pour celleux qui apprécient la traite du soir comme « un moment tranquille, voire de repos », il n’y a pas d’envie de supprimer ce moment. Mais pour d’autres, cette traite du soir est très contraignante car elle interrompt les activités de l’après-midi. « Je me sens plus efficace en monotraite, plus assidu ».
- L’usage du foncier : une question fuse : « qu’est-ce qu’on pense du fait de produire -30% de lait sur une même surface ? Est-ce ok d’utiliser du foncier pour moins produire ? ».
Les échanges mettent alors en avant que la monotraite permet de développer le produit viande sur les fermes et que, en se passant de céréales et de concentrés, des ventes de céréales peuvent se développer sur certaines fermes. « Il faudrait tout compter ! »
- Délégation : Mais alors, certains membres du groupe témoignent de leur souhait de ré-internaliser des tâches habituellement déléguées : « je veux reprendre la main sur la compta, ne plus déléguer autant, devenir plus autonome ».
Donc « tout compter » pourrait aussi vouloir dire compter l’ensemble du temps de travail nécessaire pour l’ensemble des productions ? Hum… beau chantier !
Et vous, vous vous sentez plutôt monotraite ou bi-traite ? Contrainte forte pour les un.es, moment paisible, voire rendez-vous agréable avec ses vaches pour les autres, le rapport à la seconde traite quotidienne est très personnel et fait l’objet de discussions dans le groupe Adage de Bain-de -Bretagne, comme dans bien des collectifs de travail
Un article issu de la LAD n°101
Rédigé par Mathilde Lefevre, Christophe et Laurent, groupe de Bain de Bretagne, Civam Adage 35
Aller + loin
Voir la fiche « oser le passage en monotraite en système herbager » (disponible sur cedapa.com)