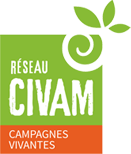Les événements climatiques, économiques, sanitaires et sociaux de ces dernières années sont sans appel : il devient impératif de transformer nos modes de production pour répondre à ses enjeux globaux sans précédents.
Pour réussir cette transition, la Politique Agricole Commune doit s’armer d’outils répondant à l’ensemble de ces enjeux. Ces outils doivent permettre d’engager un maximum d’agriculteurs, peu importe le niveau initial de leur démarche, pour les amener progressivement vers une transformation agroécologique ambitieuse de leur système. Ces mesures simples et efficaces doivent permettre de les accompagner et de les rassurer tout au long de ces changements. Ainsi, la transition des modes de production ne pourra se passer de mesures systémiques et pluriannuelles dans la lignée des MAEC Systèmes de la PAC actuelle.
Les CIVAM proposent donc des mesures systémiques, progressives, établies sur la base de contrats pluriannuels et ouvertes sur tout le territoire pour accompagner les exploitations agricoles vers l’agroécologie.
Les grandes lignes de nos propositions :
- Promouvoir des systèmes agricoles qui répondent globalement aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux
- Engager progressivement l’ensemble de l’exploitation dans une transition agroecologique
- Inciter à la transition sans entrainer d’effet de rente
- Soutenir la transition des grands systèmes de production sur l’ensemble du territoire
- Mettre en cohérence ces mesures de transition avec les autres dispositifs de la PAC
Lire le détail de nos propositions
Tenir compte des leçons de la précédente programmation PAC
La programmation 2013-2020 de la PAC s’est vue dotée d’un menu très complet de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques ( MAEC). Elles étaient déclinées sous formes unitaires, à destination de pratiques locales et ciblées, ou sous formes systémiques, à destination des exploitations dans leur ensemble.
Il en a résulté une liste de près de 10 000 mesures qui étaient proposées sur tout le territoire…. 6 000 d’entre elles n’ont finalement même pas fait l’objet de contractualisation. Les 4 MAEC Systèmes proposées nationalement se sont donc retrouvées perdues dans cette longue liste.
Les conséquences ont été peu heureuses :
- Cela a contribué à une véritable dilution de l’action publique. Cela a rendu peu efficace ces mesures de soutien au point de décrédibiliser ces approches auprès de l’administration aujourd’hui ;
- Il en a résulté un faible impact environnemental. Ceci notamment du fait du caractère parcellaire des MAEC unitaires. Mais également du fait que ces mesures n’étaient accessibles que sur certaines zones, alors que l’enjeu était bien d’amener l’ensemble des exploitations du territoire national à évoluer vers l’agroécologie.
Conditions de réussites pour des mesures agro environnementales dans la futur PAC
Pourtant, là où les mesures systèmes ont été utilisées à bon escient, de véritables changements ont eu lieu. De cette expérience, suivie de près par le réseau des CIVAM, nous pouvons tirer les principales conditions de réussite pour ce type de mesures :
- Pour trouver leur public, les mesures systèmes doivent être simples, efficaces et lisibles. Elles ne doivent ne pas être noyées dans une longue liste de mesures unitaires.
- Les Mesures Systèmes fonctionnent quand les agriculteurs qui souhaitent y souscrire sont accompagnés. Tout d’abord avant la contractualisation, pour qu’ils mesurent bien l’engagement nécessaire. mais aussi tout au long de la contractualisation pour les appuyer dans leurs changements. L’accompagnement collectif est particulièrement efficace en ce sens.
Ainsi lorsque les mesures sont claires et lisibles et que les signataires sont accompagnés, les dispositifs, même ambitieux, peuvent être sereinement mobilisé par les agriculteurs.
Nos propositions, en résumé
La PAC doit se doter d’outils appropriés et efficaces pour répondre aux grands enjeux environnementaux, économiques et sociaux actuels. Pour ce faire, elle doit proposer des mesures permettant de soutenir les agriculteurs dans la transformation de leurs systèmes vers l’agroécologie. Ces mesures, dans la lignée des MAEC systèmes actuelles, doivent :
- Être ouvertes sur tout le territoire national
- Avoir un niveau d’entrée qui permette à un grand nombre de fermes d’y émarger et de progressivement atteindre un niveau de durabilité ambitieux
- Être contractualisées sur une durée de 5 à 7 ans. Tout d’abord pour assurer cette progressivité, puis ensuite pour consolider les systèmes afin d’éviter les retours en arrière
- Engager l’ensemble de l’exploitation pour garantir une approche systémique
- Avoir une rémunération incitative pour encourager le plus grand nombre à faire le pas
- Avoir un nombre d’hectare primable plafonné par actif pour éviter les effets de cumul des aides tout en valorisant le travail plutôt que le capital
- S’articuler avec les autres dispositifs de la PAC comme les aides à l’accompagnement collectifs ou encore des mesures de l’Ecoscheme permettant le maintien de ces systèmes